
| Les
Argyrodes, autres Argyrodinae et leurs hôtes
(dont Nephila) ANATOMIE,
HISTOLOGIE ET
COMPORTEMENT DE CES ARAIGNEES :
VINGT-CINQ ANS
DE RECHERCHES
par André Lopez, auteur (Version 2025) |
|
Couleurs
conventionnelles :
En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,
noms
génériques et spécifiques ; en vert, noms de
familles et sous-familles ; en
orange,, parties
les plus importantes
et résumés ; en bleu, liens divers.
|
|
Abréviations
conventionnelles :
M.E.B.
:
(photographie en) microscopie électronique à balayage
M.E.T. :
(photographie en) microscopie
électronique à transmission
C.H. :
coupe histologique
(microscopie photonique)
|
 |
| Fig.1 - Trichonephila
turneri femelle se nourrissant d'un Lépidoptère
Charaxine dans sa toile où sont également visibles trois Argyrodes
jaunâtres (d'après Internet). |
 |
| Fig.2 - Argyrodes zonatus,
femelle, vue latérale droite. Corps : 5 mm. Voir le prosoma du mâle (M.E.T.) |
| Sur toile de Nephila comorana. N'Gouja, Mayotte (© A.Lopez) |
briller d'un vif éclat métallique argenté (Fig.3)
dû
à la guanine de
certaines cellules intestinales perçues à travers le tégument (Fig.4 :
flèches) et
responsable du nom générique (Argyros = άργυρsος, "argent" en grec),
ainsi que de leur appellation anglo-saxone de dewdrop spiders
(dewdrop signifiant
« gouttes de rosée »), par allusion
à leur forme et leur aspect
brillant qui, selon Darwin (1845),
en font "de jolies petites
araignées" .
 |
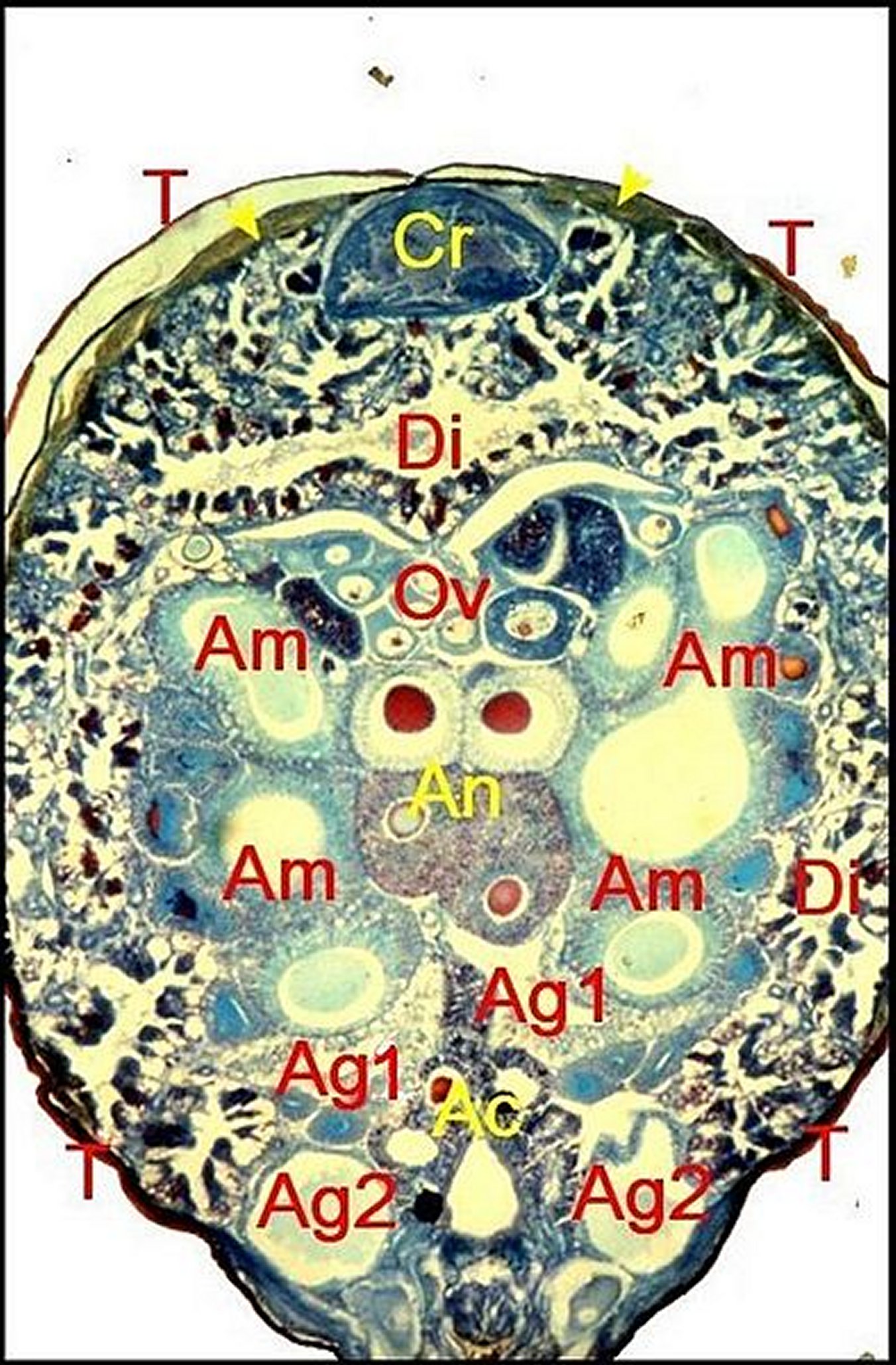 |
| Fig.3-
Argyrodes sp., femelle, vue
latérale droite. Détail de l'éclat argenté. |
Fig.4- Argyrodes argentatus, femelle, Sri-Lanka, coupe transversale de l'abdomen |
| Nashville, Tennessee. D'après
Ryan Kaldari, in Wikipedia (article A.Lopez : Lien externe 1) |
Ag1,
Ag2, glandes agrégées - Am,
glandes ampullacées - Cr, cœur - Di, diverticules intestinaux -
Ov, ovaires - T, tégument (en partie décollé).
Flèches jaunes : cellules à guanine. (C.H.© A.Lopez) |
Rappelons seulement que le prosoma des femelles a un aspect banal et assez
uniforme (Fig.5) tandis que, celui des
mâles
présente une morphologie remarquable, utilisée pour la
classification et dont
l'aspect parfois extravagant, mis en évidence par la M.E.B.
au niveau du clypeus,
associe des protubérances
diverses et des
dépressions,
échancrures
ou sillons
que garnissent des poils
(Fig.6).
5 - Autres caractères de l'anatomie interne
5-a
Divers
organes autres que les glandes à soie
6-a - Généralités On
sait que les Theridiidae
du genre Argyrodes
sont
remarquables par leur
curieuse
inféodation
aux toiles d’autres Araignées, par leur
dimorphisme sexuel prosomatique
et des cocons de forme trés particulière. Ils
possèdent un appareil
dit "stridulatoire", en fait stato-récepteur.
En Avril 1832, Charles
Darwin avait
déjà noté leur présence au Brésil,
près de Rio, lors de son célèbre
périple : "On trouve tous les sentiers de la forêt
barricadés par la forte toile jaune d'une espèce
qui appartient à la même division que l' Epeira clavipes de Fabricius...
Une jolie petite araignée, à pattes de devant fort
longues, et qui semble appartenir à un genre non décrit,
vit en parasite sur presque toutes ces toiles. Elle est trop
insignifiante, je suppose, pour que la grande Epeire daigne la
remarquer ; elle lui permet donc de se nourrir des petits insectes qui,
autrement, ne profiteraient à personne. Quand cette petite
araignée est effrayée, elle feint la mort en
étendant les pattes de devant, ou se laisse tomber hors de la toile...."(Darwin,
p.42).
Il s'est avéré postérieurement qu'outre d'autres
Araignées hôtes (Argiope, Cyrtophora,
Metepeira,
Leucauge,Theridiidae,
Pholcidae ...),
cette "Epeira", en fait Trichonephila
clavipes(Fig.9 à 12)
est, avec les autres membres de sa sous-famille, les Nephilinae, un acteur emblématique d'hébergement
pour les Argyrodes.
Seul, le genre Cyrtophora, avec son exceptionnelle toile
composite à innombrables mailles carrées,
peut rivaliser avec les Néphiles dans un tel
rôle d' "hôte".
Tous ces taxons peuvent
être retrouvés dans la Galerie
des Araignées tropicales.
Faute
de pouvoir les inclure dans d'autres parties du site, hormis la Galerie sus-mentionnée,
l'auteur
présente ici les Néphiles en raison de leur
renommée zoologique, de leur taille impressionnante rivalisant
avec celle des mygales, d'un dimorphisme sexuel volumétrique
hors du commun, de la livrée éclatante des femelles, de
l' éclat doré de leurs toiles et surtout, du
cleptoparasitisme qu'opposent à ces "géantes" les "nains"
Argyrodes.
Leur sous-famille des Nephilinae,
après avoir été incluse dans les Araneidae, a été
transférée ensuite dans les Tetragnathidae et
ultérieurement réintégrée dans sa famille
originelle. Elle comporte 7 genres: Nephila, Trichonephila,
seuls
concernés ici, Nephilengys,
Nephilingis(?),
Clitaetra,
Herennia
et Indoetra.
Il
est à retenir que deux des Nephilengys,
N.borbonica,
de la Réunion, et N.livida,
de Mayotte, Madagascar, des
Seychelles, ont été décrites et illustrées
par l'auteur dans "Wikipédia"
(Liens externes 2 et 3.) et apparaissent aussi dans la Galerie.
Les Nephila
construisent, de hauteur d' homme jusqu'à la canopée, de
grandes toiles orbiculaires
asymétriques pouvant atteindre jusqu'à 1m,50 (5 pieds) de
diamètre. Elles y demeurent en permanence, ce qui les expose aux
prédateurs. La
soie constitutive est d'une couleur jaune due à des
caroténoïdes, de l'acide xanthurénique, deux
quinones et un composé inconnu (Bor-Kai). En outre, la toile de Nephila
antipodiana
contiendrait un répulsif chimique pour protéger sa soie contre
les fourmis.
Brillant au soleil
comme de l'or,
les fils sont responsable du nom anglais
"golden silk orb-weavers" attribué à ces Araignées.
L'expérimentation
suggère que la couleur de la soie aurait un double but :
attraction des abeilles au soleil et
camouflage dans les parties ombragées. Les toiles de la plupart
des Nephila sont
complexes, avec une orbe gluante à mailles fines et
délicates et un réseau de suspension formé par des
fils barrière non visqueux le fixant sur la
végétation et autres supports. Comme chez de nombreuses
Araignées tissant une spirale adhésive, l'orbe est
renouvelée régulièrement car son
adhésivité décroit avec l'age. Par beau temps et
si la pluie n'a pas endommagé l'orbe, les adultes et
subadultes ne reconstruisent seulement qu'une portion de la toile
; ils enlèvent et consomment la portion à remplacer, y
tissent de nouveaux radii puis de nouvelles spirales. Ce
renouvellement partiel de l'orbe différencie les Néphiles des
autres Orbitèles qui le reconstruisent
généralement en entier.
Il est à noter que la toile
orbiculaire est généralement tronquée, au
sommet, par un fil support horizontal lui donnant un aspect
"incomplet" (Fig. 8). De plus, elle
est parfois complétée par un stabilimentum
défini et décrit par l'auteur dans "Wikipédia"(Lien
externe 5). Ce dispositif ("device") axial , composite et
linéaire se rencontre régulièrement chez la
Néphile de la Réunion, Trichonephila
inaurata inaurata (Fig.16 à 19), moins souvent et alors plus
réduit dans le cas d'autres
espèces comme Trichonephila clavipes
(Fig.9 et 12) et Nephila comorana
(Fig.23) . Caractéristique la plus
remarquable du
taxon réunionais (Lopez,1988), il
est ajouté aux orbes de ses femelles immatures et adultes et se
présente comme un cordon de "pelotes" ou "boulettes" anguleuses
("pellets"), toujours situé au-dessus du moyeu et ainsi, du
point de repos de l' araignée. Il peut être
appliqué sur l'un des radii supérieurs ou occuper
l'espace entre deux de ces derniers et s'étend presque
verticalement depuis le fil-cadre supérieur de la charpente et
le moyeu fermé . Les pelotes sont un mélange de
fils de soie, de débris végétaux
et surtout de vestiges de proies
(exosquelettes), espacés ou rapprochés tout au long d'un
axe soyeux multi-brins. Leur nombre varie de 2 à plus de 20 et
la longueur totale de l'ensemble peut atteindre 20 cm......
 |
| Fig.8 - Toile de Nephila inaurata. L' Araignée(femelle) est installée sur le moyeu excentrique et supérieur. White Sands, près de Mombasa, Kénya (© A.Lopez, d'après une diapositive). |
 |
 |
 |
|
Serra do Cantareira, Sao Paulo,
Brésil.
(© Benoît Lopez, 2008) |
Fig.10 - Trichonephila
clavipes, autre femelle sur sa
toile. Mont Cabassou, Guyane française.
(© A.Lopez)
|
Fig.11 - Trichonephila
clavipes, autre femelle et mâle
(flèche). Forêt du Rorota, Guyane française.
(© A.Lopez)
|
| |
 |
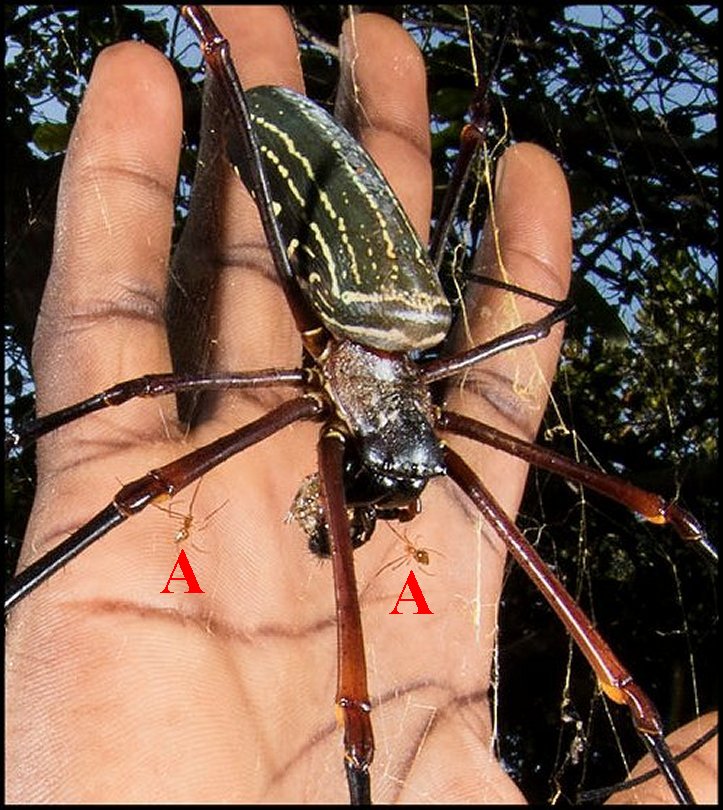 |
 |
|
Fig.13 - Nephila
constricta, femelle, vue dorsale,. forêt
équatoriale du Cameroun.
(© A.Lopez, d'après une
diapositive).
|
Fig.
15 - Nephila
constricta, femelle, présentée sur sa toile
où apparaissent deux Argyrodes
sp. avec une paume de
main en "toile de fond".
Photo
Filippo Bortolon, Internet.
|
Fig.14
- Nephila
constricta, femelle, vue dorso-latérale droite. La
même que dans la Fig.12. (© A.Lopez, d'après une diapositive). |
| Pas
d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile |
Argyrodes
sp., A. |
Pas d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile |
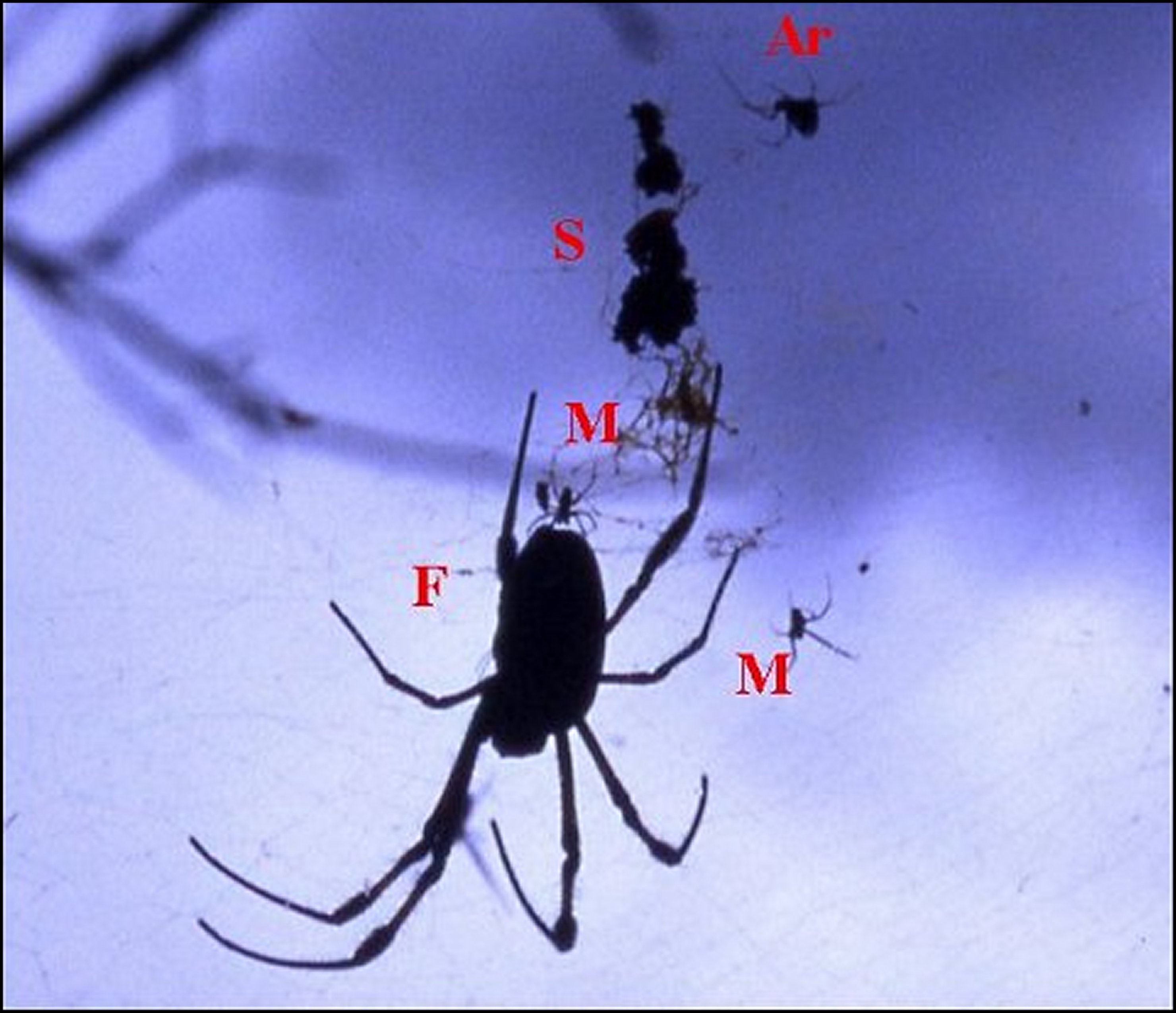 |
| Fig. 19
- Même femelle, autre vue |
|
Ar,
Argyrodes - F, femelle - M, mâles - S, ébauche de
stabilimentum.
|
 |
 |
 |
| Fig. 20 - Trichonephila inaurata madagascariensis. Femelle sur sa toile, vue ventrale. Nossy-Sakatia(© A.Lopez) | Fig.22 - Trichonephila inaurata madagascariensis, autre femelle, vue frontale, photographiée à contrejour, en hauteur et au téléobjectif. Près de la forêt-réserve de Lokobé, Nossy-Bé (© A.Lopez,) | Fig. 21- Même individu que dans
la Fig.20.Vue latérale gauche de la femelle et de sa toile
à orbe dorée (©
A.Lopez) |
| Pas d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile | Flèche jaune: débris de
proies. Flèches rouges : 4 Argyrodes
sp. Les autres petites araignées sont des juvéniles
("spiderlings") indéterminables.
|
Flèche : Argyrodes
zonatus sur fil tendeur du
cadre. |
-
 |
 |
 |
|
Fig.25
- Nephila
inaurata,
femelle, vue dorsale, près de Mombasa, Kénya (© A.Lopez)
|
Fig.26
- Même femelle,
vue latérale gauche
(© A.Lopez) |
Fig.27
- Nephila
inaurata,
autre femelle, vue dorsale (© A.Lopez)
|
 |
 |
 |
|
Fig. 28 - Trichonephila
fenestrata venusta. Femelle
sur sa toile, vue dorsale. Forêt
équatoriale du Cameroun près de la Sanaga.
(© A.Lopez, d'après une
diapositive).
|
Fig.29 - Trichonephila
fenestrata venusta. Autre femelle
sur sa toile, vue latéro-dorsale gauche. Forêt
équatoriale du Cameroun près de la Sanaga.
(© A.Lopez, d'après une
diapositive).
|
Fig.30 - Trichonephila
fenestrata venusta. Autre femelle
sur sa toile, vue dorsale. Cameroun (d'après Internet : Colombia naturalist) |
| A,
Argyrodes
sp. - P, menus
Insectes (Diptères) englués sur la toile |
Pas d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile | A, Argyrodes
isolé- M, mâle. |
Toutefois, en dehors des
Mammifères, la
grande majorité des femelles sont plus volumineuses que leurs
mâles. Ainsi, chez les Poissons, il existe un dimorphisme
sexuel extrême et caricatural dans le cas du "diable de mer
à trois verrues", Cryptopsaras couesii (Lophoiiformes : Ceratiidae), poisson pêcheur des
grandes profondeurs dont le mâle (1 à 3 cm) se trouve
réduit à un parasite externe miniature fixé sur la
femelle comme une excroissance.
Loin des Vertébrés et dans tout le Monde animal terrestre,
c'est la Néphile qui exhibe le dimorphisme sexuel
volumétrique le plus extrême.....Ayant
perdu, à maturité, le pouvoir de tisser la soie de
capture visqueuse qui englue des proies et ne pouvant se fixer
sur la femelle pour dépendre de son hémolymphe, il
doit lui
dérober de la nourriture, tout comme les Argyrodes
et se comporte
aussi, vis à vis
d'elle comme un véritable kleptoparasite, ce qui lui permet de
survivre.
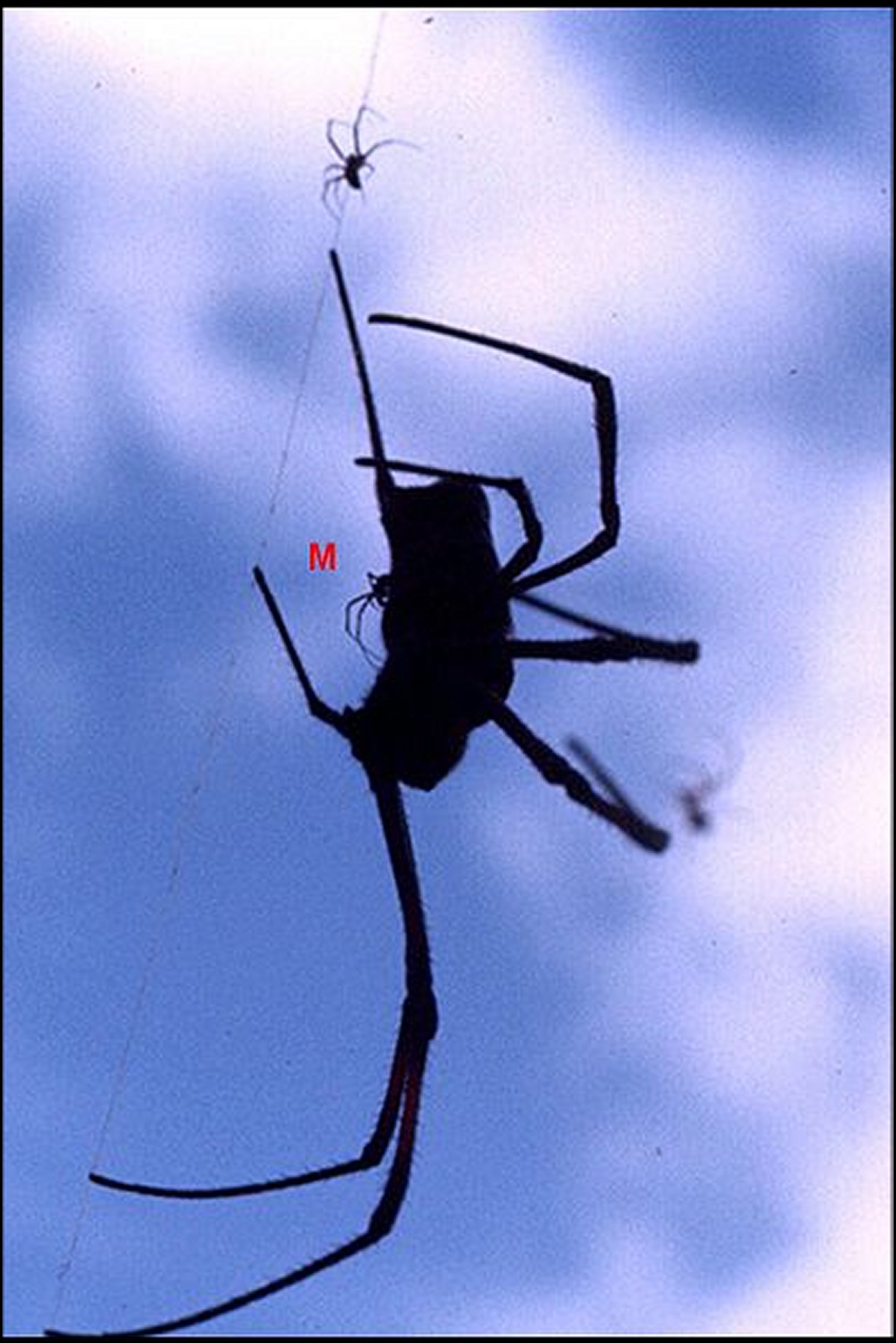 |
 |
 |
|
Fig.31
- Nephila
inaurata,
femelle, vue à contre jour, près de Mombasa, Kénya , avec trois mâles dont un (M) in copula (© A.Lopez)
|
Fig.32 -La même avec deux mâles
seulement dont un de face montrant ses bulbes (© A.Lopez). |
Fig.33
- Nephila
comorana,
femelle, vue ventrale, surmontée par un mâle. "Jardin mahorais", près de
N'Gouja, Mayotte
(© A.Lopez)
|
 |
 |
 |
| Fig.36
- Argiope
nigrovittata, femelle, vue dorsale, avec une partie du stabilimentum (S) et un Argyrodes
(Ar). Cameroun (© A.Lopez, d'après une
diapositive).
|
Fig.37 - Argyrodes
elevatus (nombreux petits points brillants, en bas et
à
droite), sur une toile d' Argiope argentata (F,
femelle - M, mâle). Guadeloupe
(© A.Lopez)
|
Fig.38
- Argiope
bruennichi, femelle, vue dorsale. Un Argyrodes
est visible sur la
toile, en haut et
à gauche. Espagne, trouvé sur Internet.
|
 |
|
Fig.39 - Argyrodes
elevatus sur une toile de Metepeira
avec sa retraite (R) : 1 mâle (flèche) et 2 femelles.
Guadeloupe
(© A.Lopez, d'après une
diapositive).
|
Contrairement à la
majorité des Aranéides, les Argyrodes
sensu stricto sont incapables de mener dans la Nature une
existence indépendante, ce qui les différencie d'autres
Argyrodinae. Leur vie se
trouve assujettie à
la présence de Theridiidae différents
(Anelosimus
eximius, taxon social de
Guyane, cas dans lequel l'auteur
a constaté une certaine
spécificité vis à vis de l’hôte (Lopez,1987)),
d’ Eresidae
(Stegodyphus), de
Pholcidae
(Holocnemus…) et surtout, d’ Araneidae orbitèles. Les plus
recherchés de ces derniers hôtes sont les genres Micrathena, Argiope, et surtout, Cyrtophora ainsi que Nephila) dont elles habitent la
toile en tous lieux : rochers, végétation depuis les
semi-déserts jusqu'à la forêt
équatoriale, et même constructions humaines. Elles y
installent leurs curieux
petits cocons en "mongolfière": cocon),
s’y nourrissent de débris alimentaires et de proies
engluées, menues mais parfois aussi très grosses,
isolément ou en même temps que l’hôte. Legendre
(1960) a défini ce type de relations comme un cas
particulier d'
"inquilinisme",
terme auquel est substitué aujourd’hui celui de
kleptoparasitisme
(du grec kleptein
= voler).Un possible avantage
de voler des
proies et de se nourrir avec l’hote est la prédigestion
partielle de cette nourriture, comme l’a suggéré Kullmann
(1959), ce qui peut être specialement avantageux pour de
très
grosses proies.
Le
vol de nourriture par une grande quantité de kleptoparasites
peut contraindre l'hôte à se déplacer pour
construire ailleurs une nouvelle toile comme Rypstra l'a observé au
Pérou en 1979 y
constatant la grande mobilité d'une
population of Nephila clavipes relativement au nombre
des Argyrodes.
Les
Néphiles déplaçant leur toile avaient
consommé significativement moins de proies que celles la laissant en place.
Quoi qu'il en soit, le propriétaire légitime de la toile tolèrerait les Argyrodes “ commensaux ” faute de pouvoir les chasser et il semblerait donc que les Argyrodes soient pourvus d’un moyen défensif qui les met à l’abri des entreprises violentes de l’ hôte.
Le kleptoparasitisme vis à vis des Araignées n'est pas le propre des Argyrodes puisque certains Insectes, en particulier des micro-Diptères de la famille des Milichiidae et surtout du genre Desmometopa sont attirés par l' Arachnide (Fig.40 et 41) (ou autres Arthropodes carnivores comme les Réduves dans la garrigue) en train de se nourrir et viennent s'abreuver aux fluides émis par les pièces buccales de ce dernier ainsi qu'à ceux qui s'écoulent du corps meurtri de la proie. Il s'agit en pareil cas d'un "dipsoparasitisme»" (du grec dipsos= soif) présenté par l' auteur dans "Wikipédia"( Lien externe 4).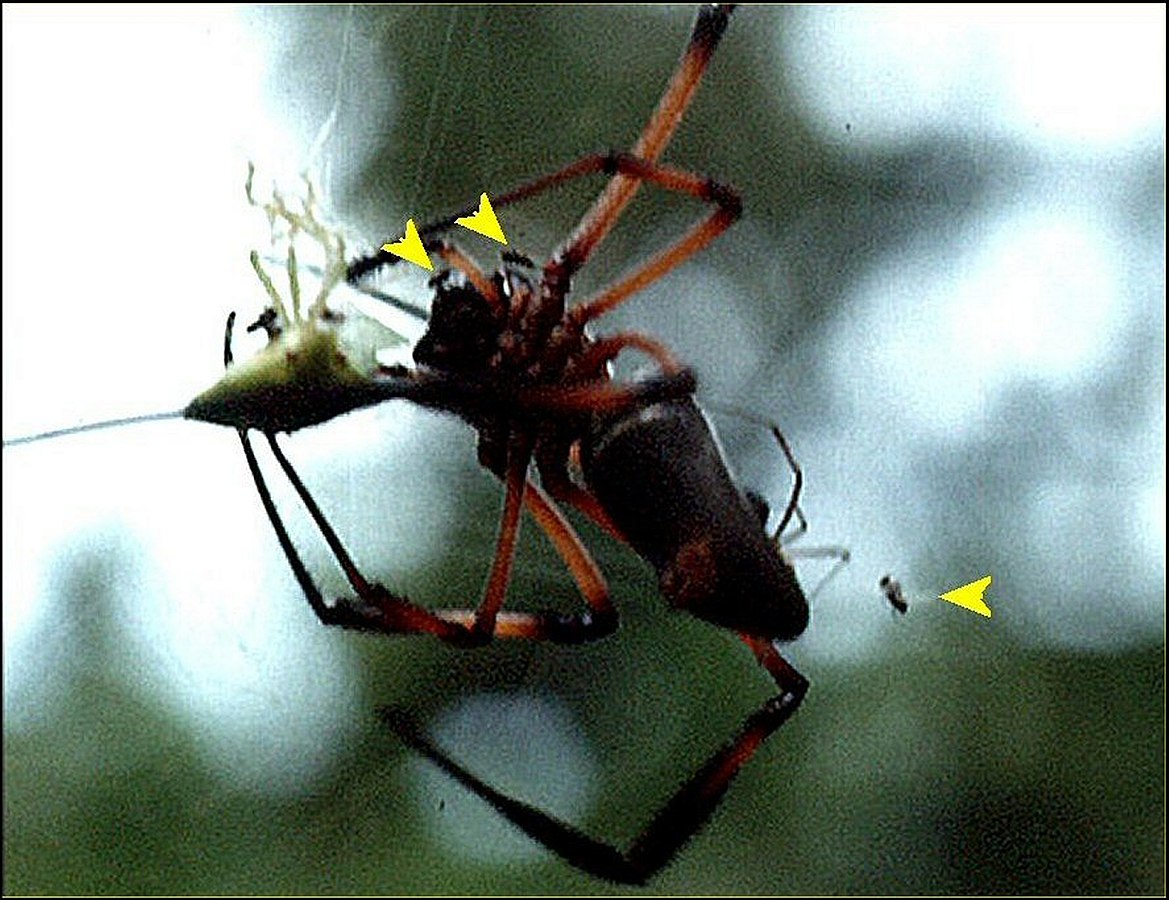 |
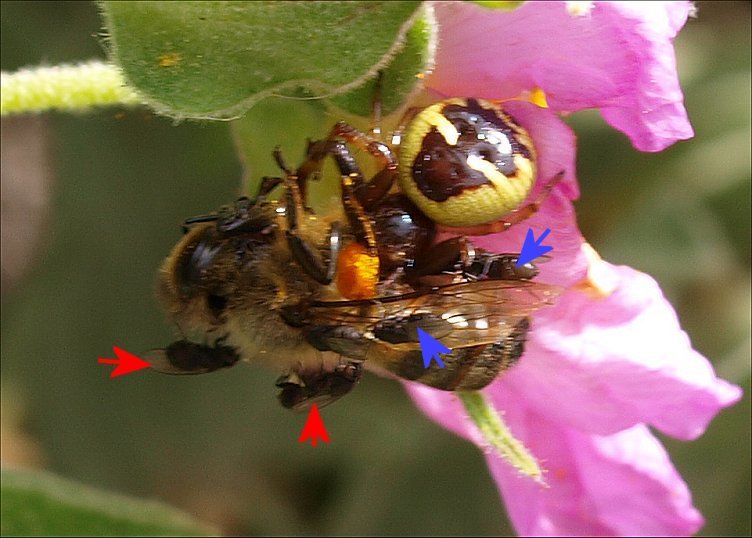 |
|
|
Fig.40
- Trichonephila
inaurata
seychellensis
se nourrissant d'une punaise pentatomide. Flèches jaunes : Milichiidae. La
même que dans la Fig.35.
Île
de Mahé, Seychelles (© A.Lopez, d'après une
diapositive).
|
Fig.-41 - Araignée Thomiside Synema globosum se nourrissant d'une abeille et Milichiidae commensaux (flèches). Garrigue languedocienne(© A.Lopez). |
6-d-2 -L'arachnophagie
De plus, les Argyrodes
manifestent une arachnophagie indiscutable car ils peuvent non
seulement se nourrir des jeunes de l'Araignée hôte,
à leur sortie du cocon ovigère mais même de
cette dernière, après l'avoir attaquée, lorsqu'elle est de
petite taille ou lorsqu'elle est en train de muer .
C'est ainsi que dans le Maryland,
Argyrodes
trigonum décrit comme commensal de l'
"Araignée labyrinthe" Metepeira
labyrinthea, se
nourrit fréquemment de son hôte dont il peut impacter les
populations (D.Wise,1982).
En
fait, la relative immunité dont bénéficient les Argyrodes dans leurs rapports
avec l’Araignée-hôte n’est nullement concernée. La glande
clypéale ou acronale ne
peut être
considérée comme un organe de défense élaborant
une substance répulsive ou
vulnérante à
l’instar des Insectes : elle manque chez les femelles ;
l’absence de musculature compressive et la terminaison des canaux
excréteurs dans une région anfractueuse conformée
en cul de sac, n’impliquent pas une projection de substance ou sa
libération massive lors des “ stress ”.
D’autres
facteurs interviennent dans la protection des Argyrodes :
♦ le camouflage
(crypsis), les Argyrodes
se tenant au repos toujours suspendues ventre en l’air dans les toiles
où elles rappellent une goutte d’eau par leur éclat
argenté ou des détritus tombé accidentellement sur
les fils ( petite taille : quelques mms.; couleur d’ensemble brun-jaune
clair ; abdomen de profil triangulaire ; position des pattes
(PI et
II) étendues
vers l’avant (Fig.42,44 ou fléchies et
appliquées alors contre l’abdomen (Figs.47 à 29).
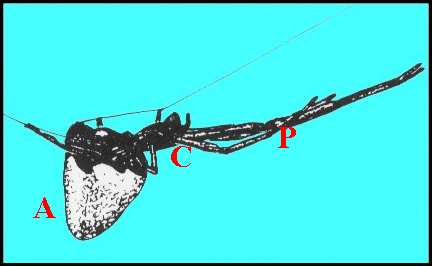 |
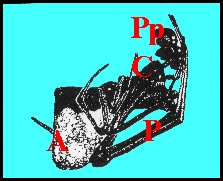 |
 |
| Fig.42- Argyrodes sp., femelle, pattes
étendues (dessin) |
Fig.43 -
Mâle,
pattes fléchies (dessin) |
Fig.44
- Argyrodes
argyrodes, femelle pattes
étendues. |
| A, abdomen - C, céphalothorax - P, pattes -Pp, palpes. Vues latérales gauches | ||
♦ Des déplacements
très lents et precautionneux pour eviter la stimulation de
l’hôte, lorsque ce dernier est immobile.
♦ Une
grande prestesse dans l'esquive liée à leur
sensibilité tactile, à des réflexes trés
rapides et au fait que lors des vibrations anormales de la toile, les Argyrodes s'en laissent choir
brutalement comme "des goutelettes d'argent", au bout des fils de
rappel que produisent des glandes à soie
ampullacées plus volumineuses que chez les autres Theridiidae (Lopez,1983).

|
 |
 |
| Fig.45 - Argyrodes cognatus
mâle en
déplacement sur une toile de Cyrtophora.
Seychelles. (© A.Lopez) |
Fig.46 - Argyrodes cognatus
mâle cryptique, pattes
étendues. Mahé
(Seychelles). (© A.Lopez) |
Fig.47 - Argyrodes ululans
mâle
cryptique, pattes étendues, toile d'Anelosimus. Guyane.
(© A.Lopez) |
l |
|
Fig.48 -
Argyrodes sp.,
femelle pattes étendues en position cryptique,
dans une toile de Théridiide.
Pénédo
(Brésil : état Rio de Janeiro,Sept.2007).
(© A.Lopez) |
Pour certains arachnologistes
(Peng & al.,2013
) se basant sur des expérimentations, le
système relationnel
considéré comme kleptoparasitique s'accompagnerait en
fait d'une forme de mutualisme, la coloration corporelle
de l' Argyrodes
(en l'occurence A.fissifrons)
et son éclat argenté étant bénéfique
pour l'hôte (Cyrtophora
unicolor) car sa présence, rappelant la lumière
des étoiles que perçoivent les photorécepteurs d' Insectes, attirerait d'avantage
ces derniers (notamment des
Hétérocères) dans la toile de
l'Aranéide qui, réciproquement, y tolèrerait
l'accés de l'inquilin. Il s'agirait donc d'un exemple de
relation entre deux Arthropodes prédateurs, la coloration d'une
espèce renforçant
pour l'autre les gains alimentaires .
Le kleptoparasitisme est une caractéristique obligatoire des Argyrodes sensu
stricto. En revanche, chez
les autres Argyrodinae, le
genre Rhomphaea
(Fig.49 à 51) bien qu'observé
occasionnellement sur la toile d'autres
Araignées (Cyrtophora
par exemple) mêne une existence indépendante, utilise le
camouflage dans la végétation par ses couleurs ainsi que
son contour anguleux, la forme du corps et les pattes repliées
évoquant une débris de plante (Fig.50,51). Son nom
étrange
dériverait d' une arme de combat des anciens Thraces !
 |
||
| Fig. 49 - Rhomphaea
errante
d'après Phil Bendle |
Fig 50- Rhomphaea à l'affut d'après bio-scène.org. | Fig.51 - Rhomphaea nasica se nourrissant d'une proie emmaillotée. D'après H.Dumas |
Elle manifeste a un
comportement prédateur d'attaque,
parfois sophistiqué, avec de la soie visqueuse (Fig.51).
De même, le genre Ariamnes a une vie libre et peut
capturer des Araignées errantes (jeunes, mâles) ou de
petits Diptères (Mycetophilidae)
s'aventurant ou se reposant sur
sa toile, réduite à quelques fils (2 à 7) longs et
grêles, en réseau tridimensionnel fort lâche entre 1
et 2 m au-dessus du sol. Comme le rappelle Eberhard
(1980), tels
sont les cas d'Ariamnes
colubrinus, flagellum
et attenuatus, cette dernière
utilisant même un fil de soie visqueuse extrait des
filières et manipulé avec ses pattes postérieures
pour en envelopper la proie (Fig. ). Curieusement, aux îles
Hawaï, où les Ariamnes, souvent nocturnes et à abdomen
d'allongement varié semblent
abonder, certaines espèces, mènent une vie soit
entièrement libre, soit "mixte" à la fois
kleptoparasitique sur les toiles des Orsonwelles
(Linyphiidae
endémiques d'Hawaï), soit
enfin indépendante
, ce qui prouve que
le kleptoparasitisme peut être
facultatif, contrairement
à plusieurs groupes d'espèces d'Argyrodinae chez lesquels il se
présente comme obligatoire.
Outre le vol de nourriture et en tant
qu'abri, les Argyrodes
utilisent les toiles de leurs hôtes comme
un lieu électif pour la reproduction, à savoir
l'accouplement qui révèle un comportement sexuel
trés particulier impliquant la glande acronale ou clypéale, et la ponte qui
met en jeu des cocons
originaux, partie de
leur industric séricigène.
 |
 |
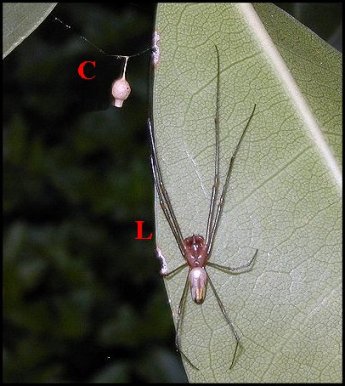 |
|
Fig.52
- Argyrodes
argyrodes : cocon
sur une
toile d'Holocnemus.
(Pholcidae), Tunisie
(© A.Lopez)
|
Fig.53 -Cocon
d' Argyrodes argentatus et femelle
sur
une toile d' araignée coloniale, Sri-Lanka.
(© A.Lopez)
|
Fig.54
-Cocon d' Argyrodes sp. (C)
sur une toile de Leucauge argyra (L).
Guadeloupe
(© A.Lopez) |
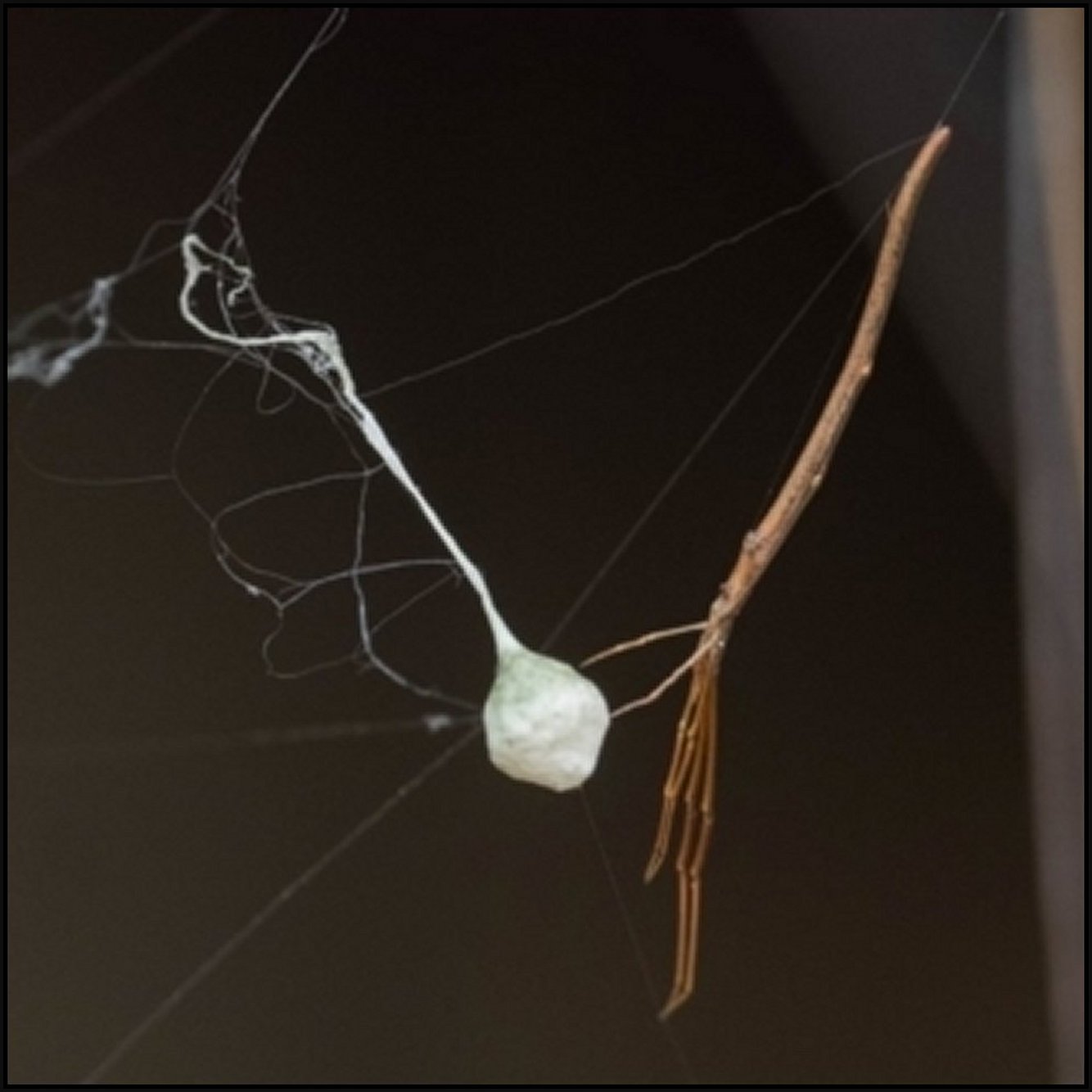 |
 |
 |
 |
||
| Fig. 55 - Ariamnes
colubrinus, femelle, et son cocon. Sur Internet. |
Fig. 56 - Rhomphaea sp., femelle et son cocon. Sur Internet. |
Fig.
57 -
Neospintharus trigonum, femelle et son cocon.
Sur Internet.
|
Fig. 58 - Spheropistha (melanosoma)
femelle
et son cocon. Sur Internet.. |
 |
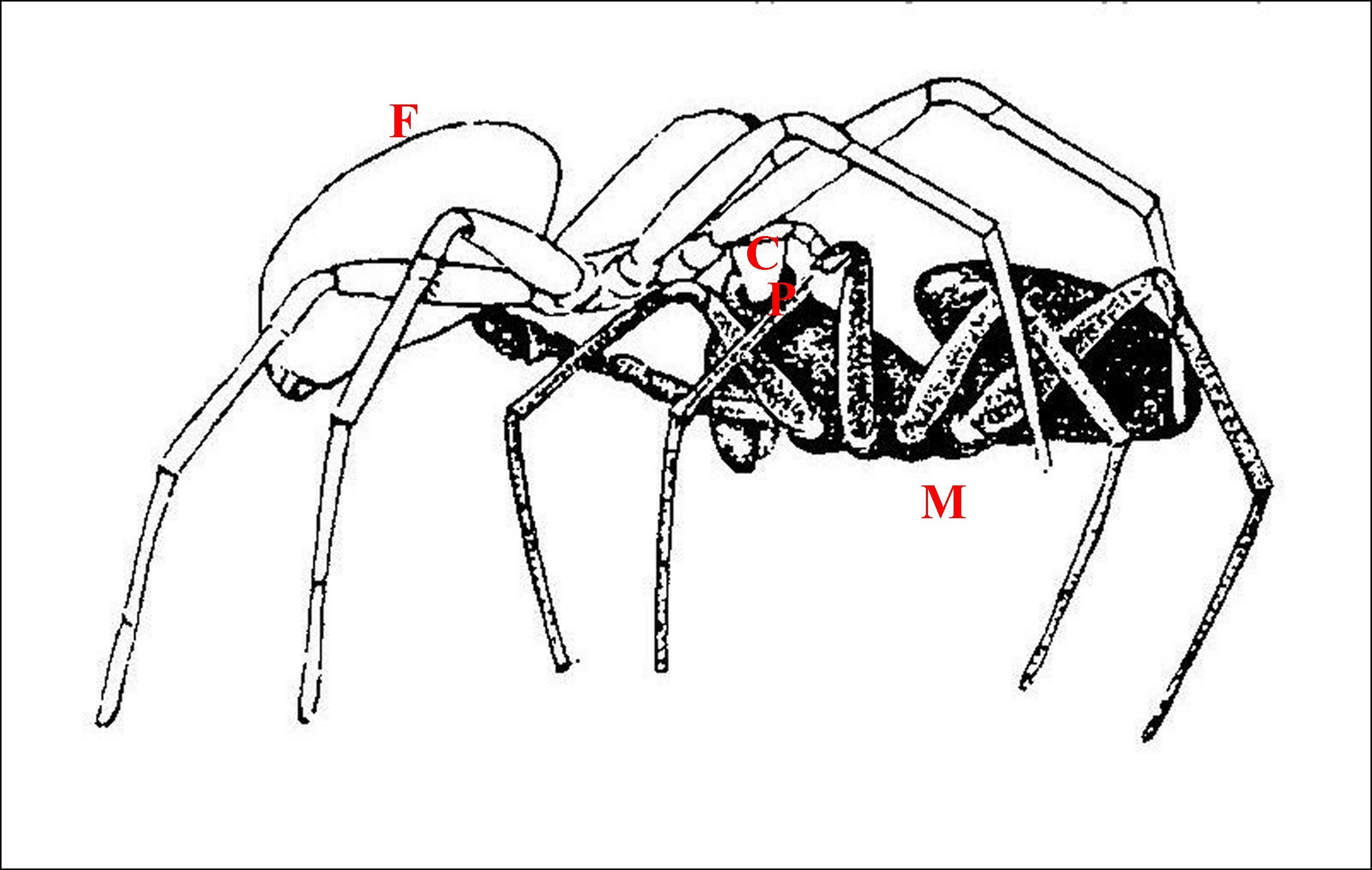 |
|
Fig.59-
Argyrodes argyrodes (Cap Vert), accouplement
: étreinte du céphalothorax mâle par la femelle.
(d'après
B.Knoflach, Internet)
|
Fig.
61- Hypomma
bituberculata, accouplement : étreinte
du céphalothorax mâle par la femelle (d'après
Millot, 1968 : fig..520, p. 732 : "une
curieuse
bosse céphalique enserrée dans les
chélicères (femelles)au moment de l'accouplement"
|
| B, bosse frontale - C, chélicères femelles - F, femelle - M, mâle - P, protubérance oculaire . | |
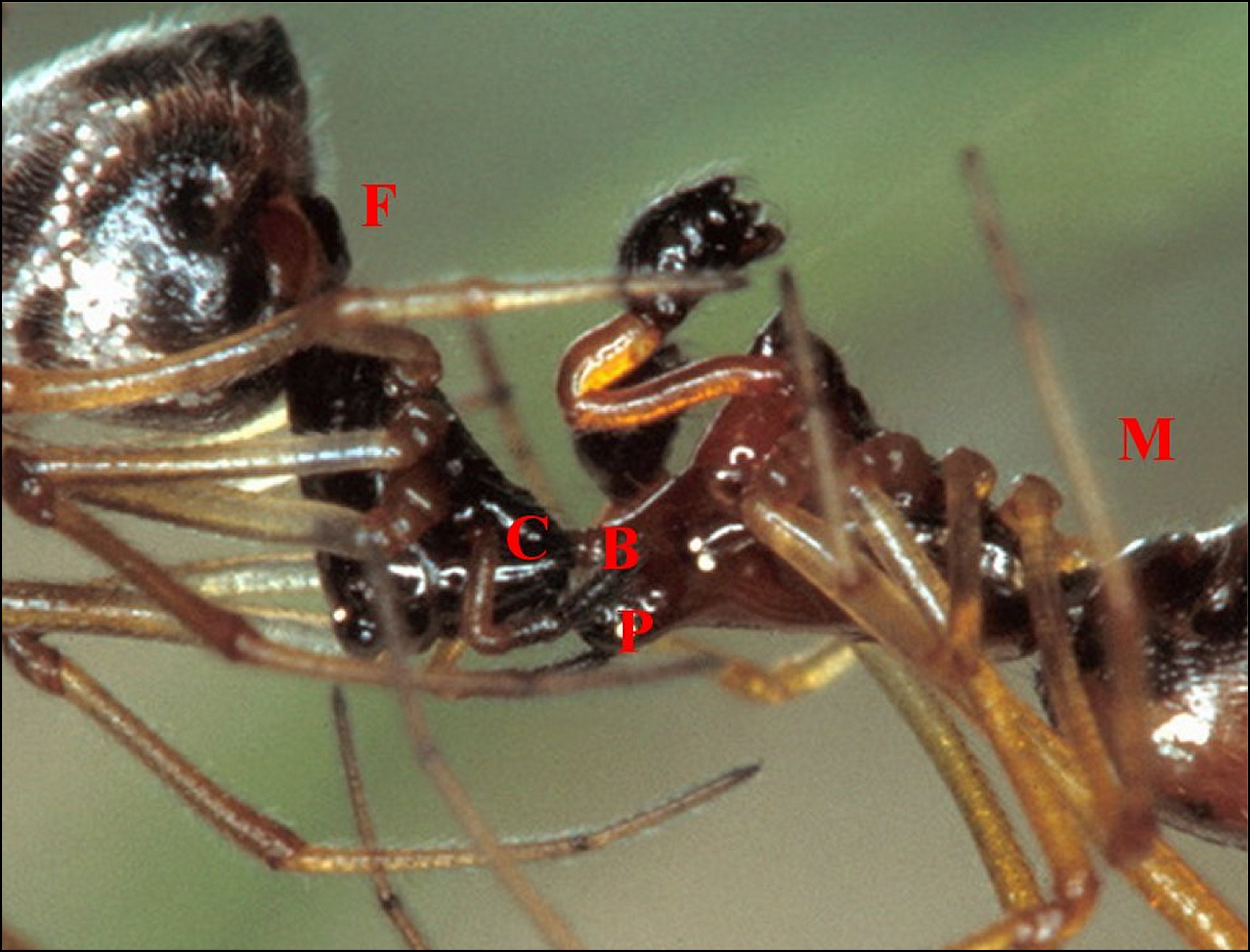 |
| Fig.60 -
Détail de la Fig.59. Mêmes légende et signalisation |
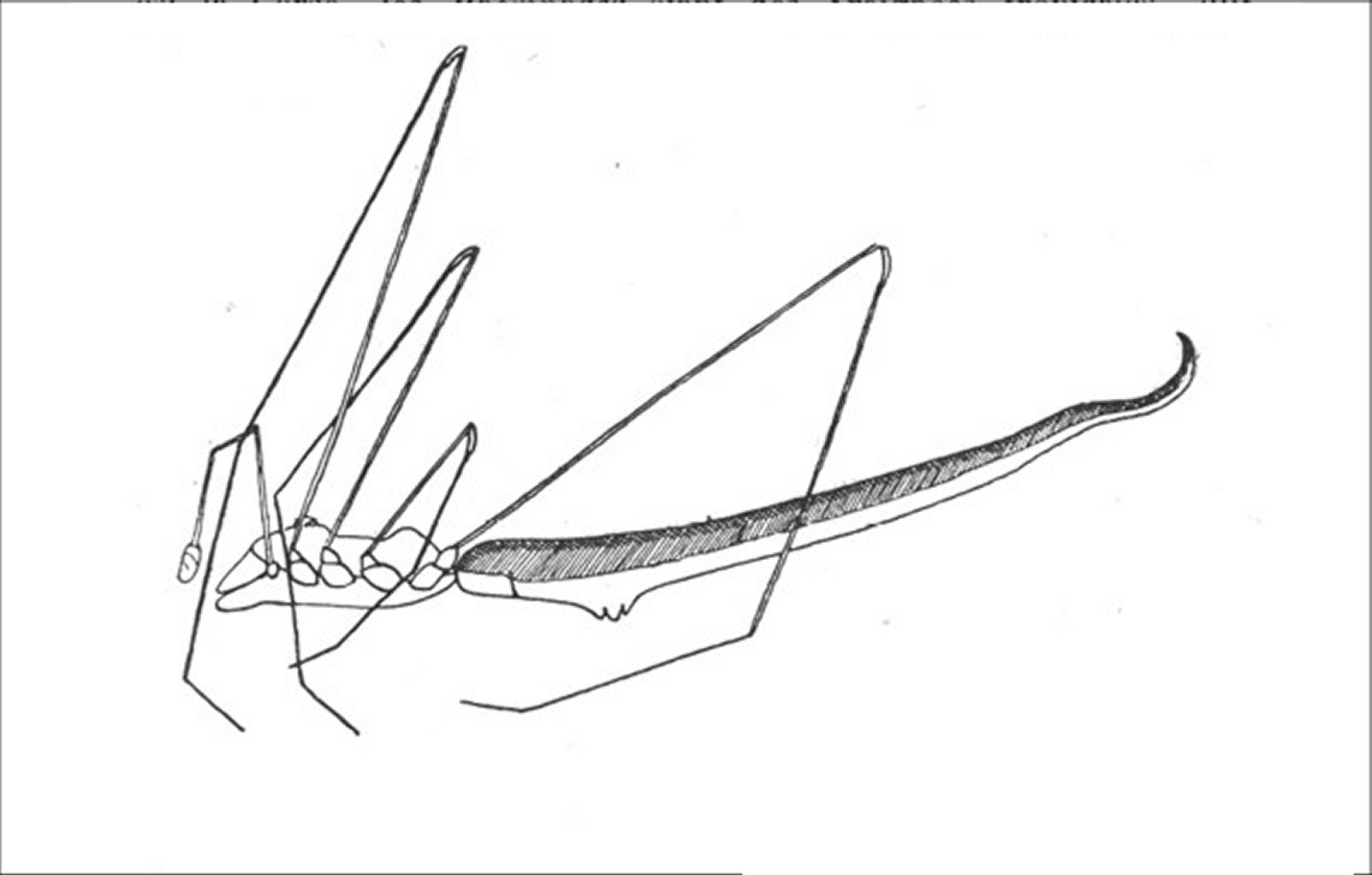 |
 |
| Fig.62 - Rhomphaea
rostrata, mâle. Vue latérale gauche totale,
avec le long abdomen vermiforme et le prosoma à clypeus
allongé sub-horizontal (d'après Berland : dessin). |
Fig. 63- Rhomphaea rostrata, mâle. Détail. Vue dorsale inversée du prosoma avec les palpes, leurs bulbes et le long clypeus oblique, sans reliefs (d'après Bartolucci). |
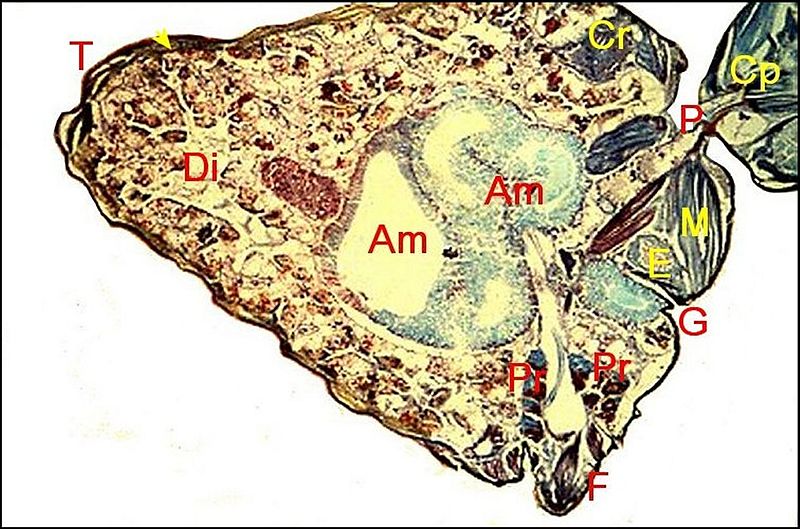 |
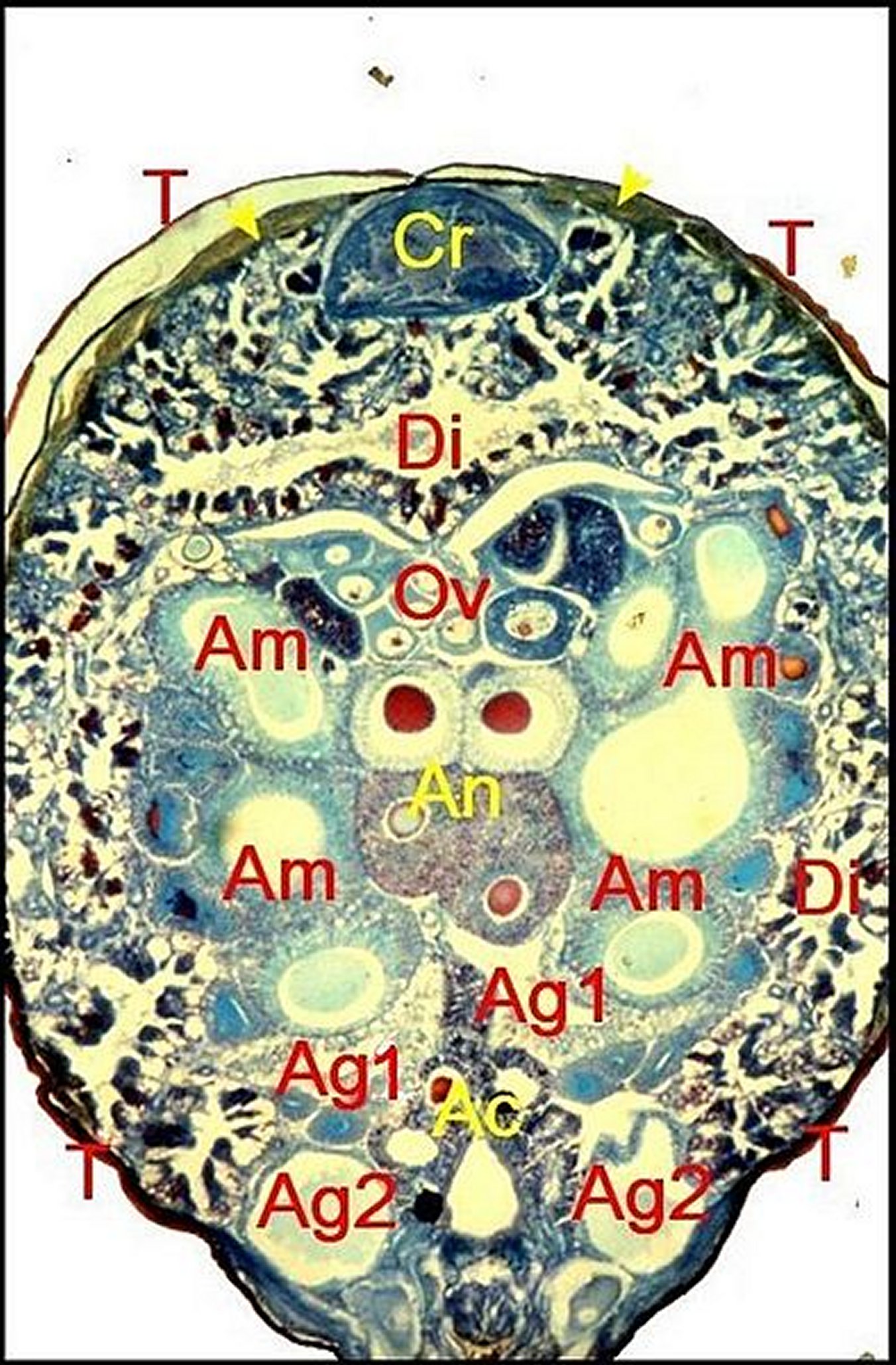 |
| Fig.64- Argyrodes argentatus femelle, Sri-Lanka,coupe sagittale de l'abdomen. | Fig. 65- Argyrodes argentatus, femelle, Sri-Lanka, coupe transversale de l'abdomen |
| Ag1,
Ag2, glandes agrégées -Am,
glande ampullacée - c,
glandes aciniformes - Cp,
céphalothorax - Cr, cœur -
Di, diverticule intestinal - F, filière - G, orifice
génital - M, muscle -Ov, ovaires - P, pédicule - Pr,
glandes
piriformes.T, tégument (en partie décollé).
Flèches jaunes : cellules à guanine (C.H.© A.Lopez) |
|
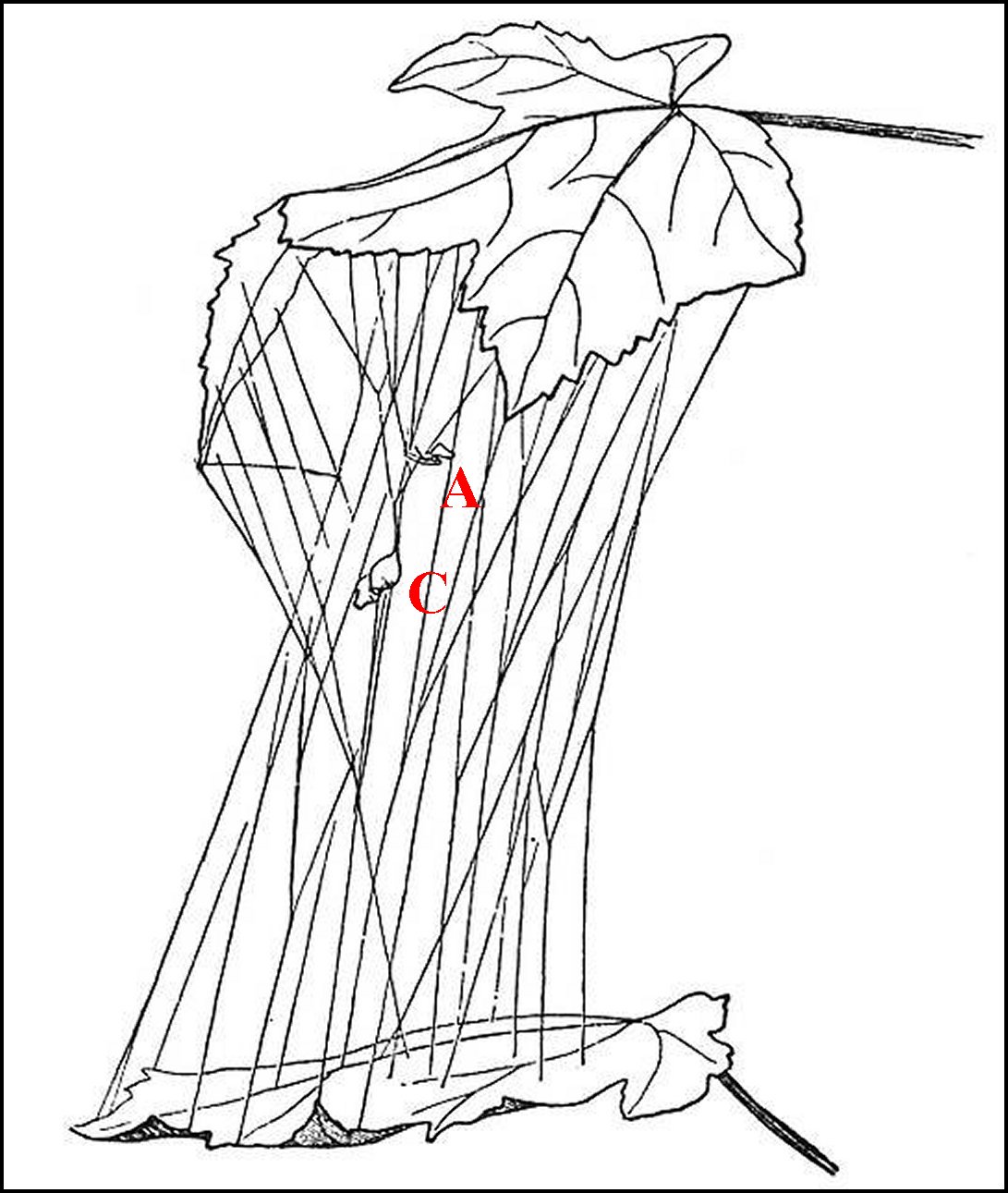 |
|
Fig.
66 - Toile Neospintharus
trigonum tissée sur un érable
D'après "The Common Spiders of the United States". Ginn & Company. Boston. 1902 |
| A, araignée - C, deux cocons |
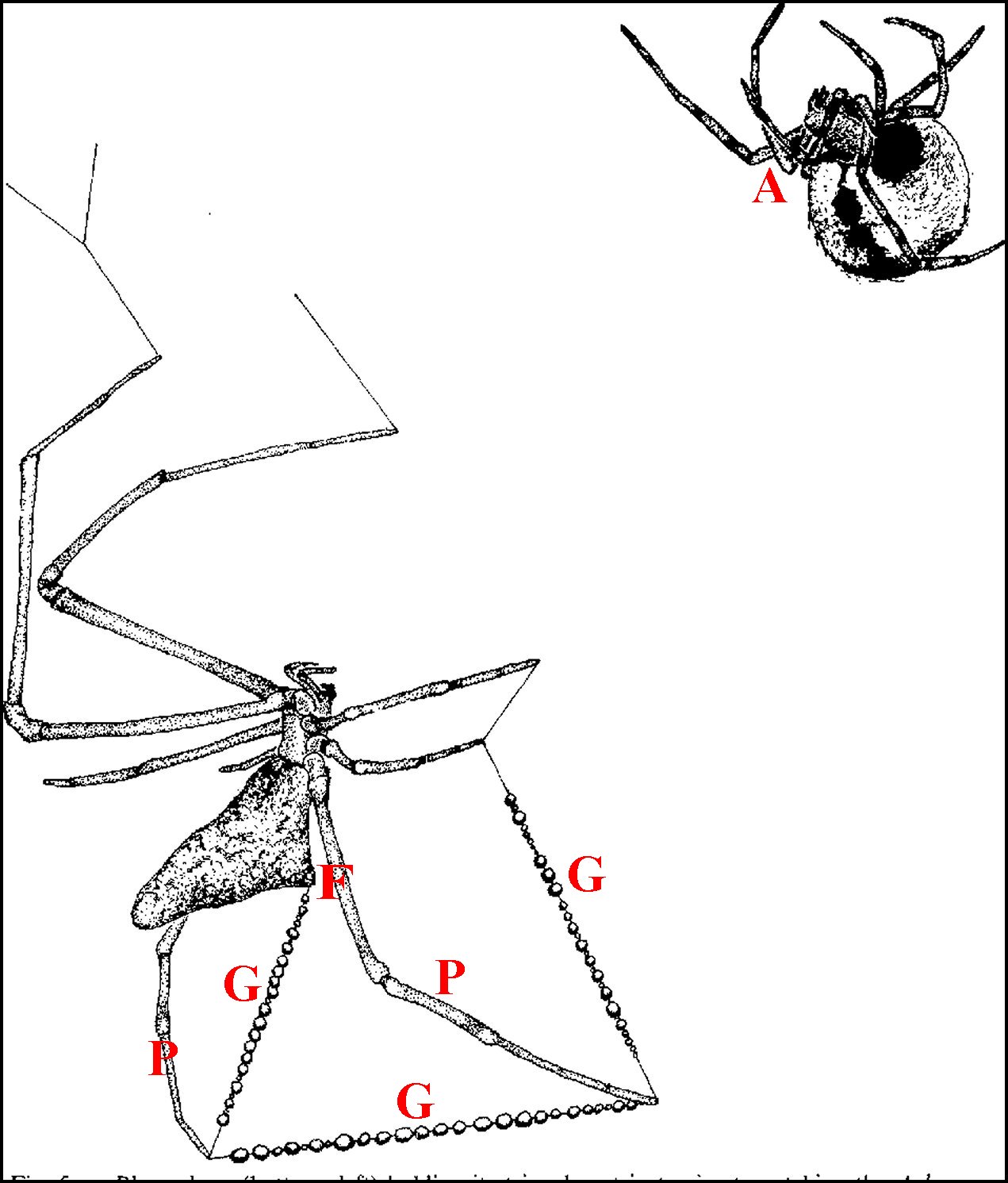 |
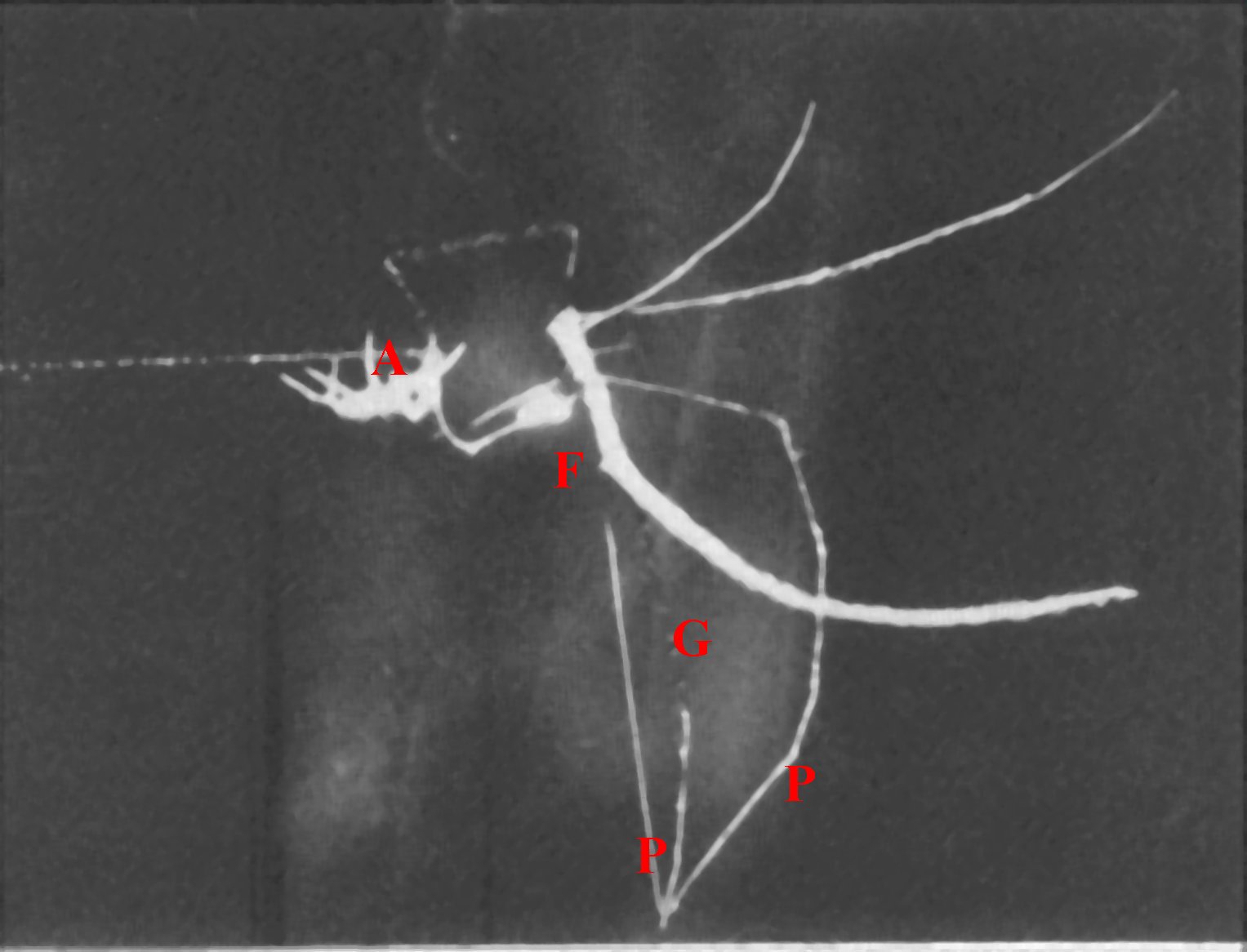 |
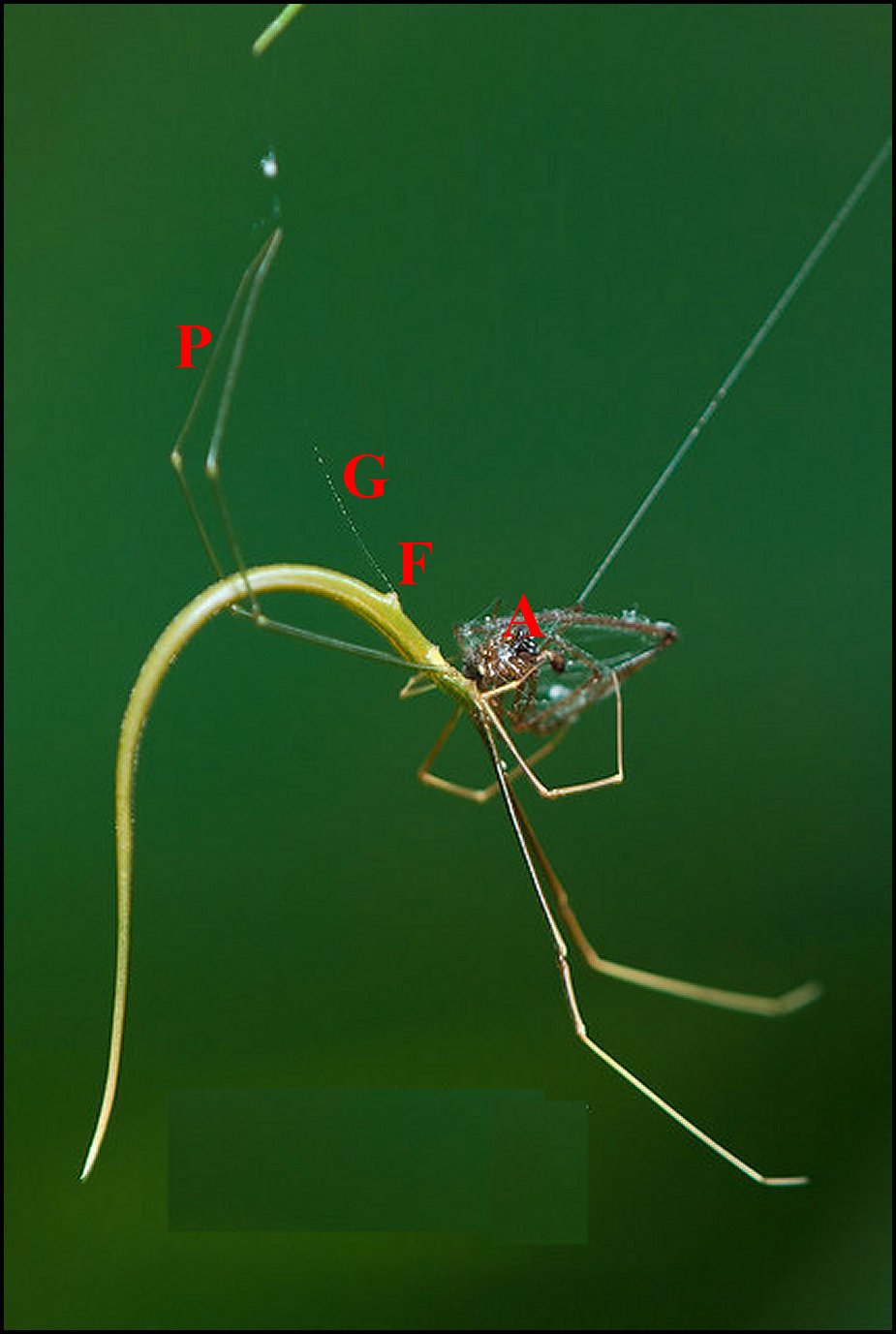 |
| Fig. 67- Rhomphaea
sp. s'approchant d'une autre araignée pour projeter sur
elle son filet en trapèze de soie gluante (d'après
Whitehouse, 1987) |
Fig. 68 -Ariamnes
attenuatus , femelle sur sa toile rudimentaire
étirant avec ses pattes postérieures un fil gluant
qu'elle projetera sur une petite araignée pour la capturer (D'après une mauvaise photographie d' Eberhard, 1979) |
Fig. 69- Ariamnes
flagellum, femelle dévorant sa proie qu'elle vient
d'engluer avec les pattes postérieures
(D'aprèsNicky Bay)
|
| A,
araignée-proie - F, filières - G, fils gluants - P,
pattes postérieures. |
||
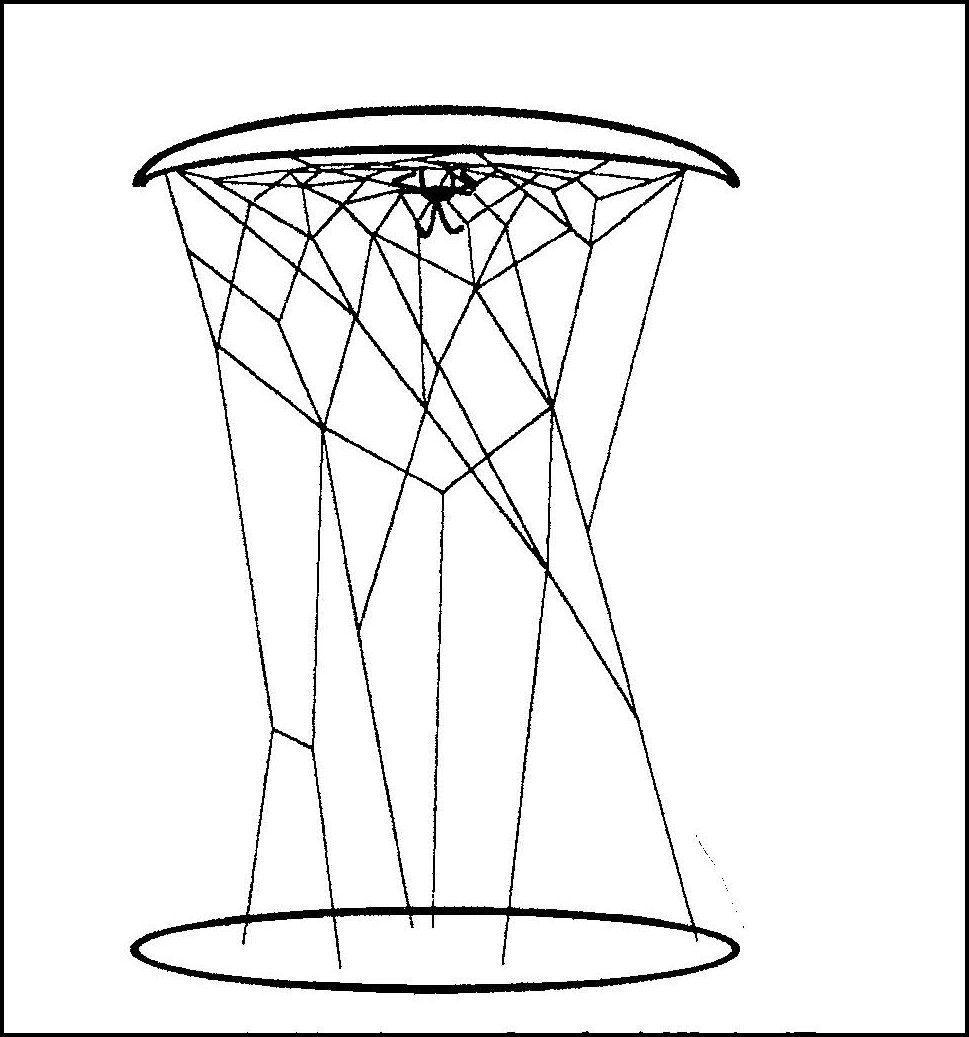 |
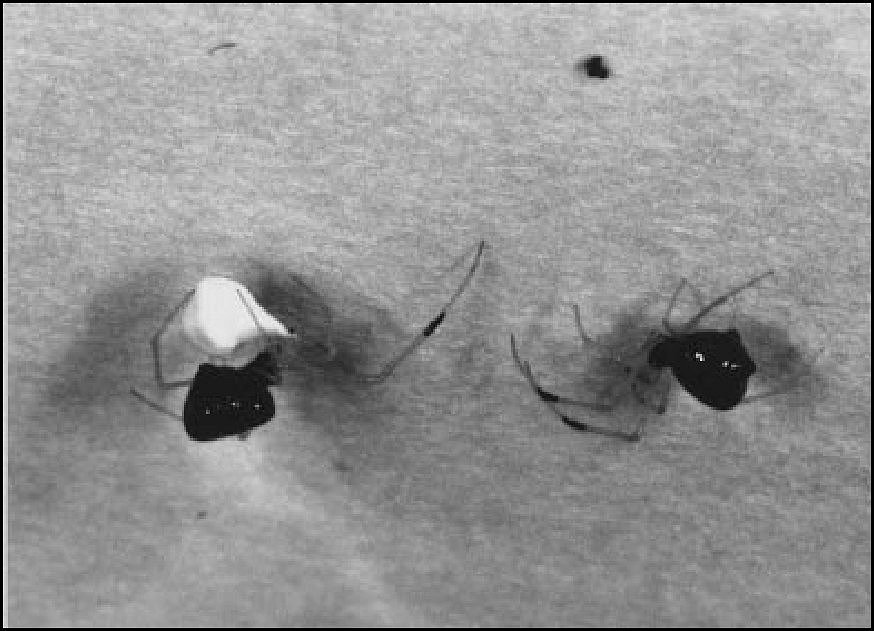 |
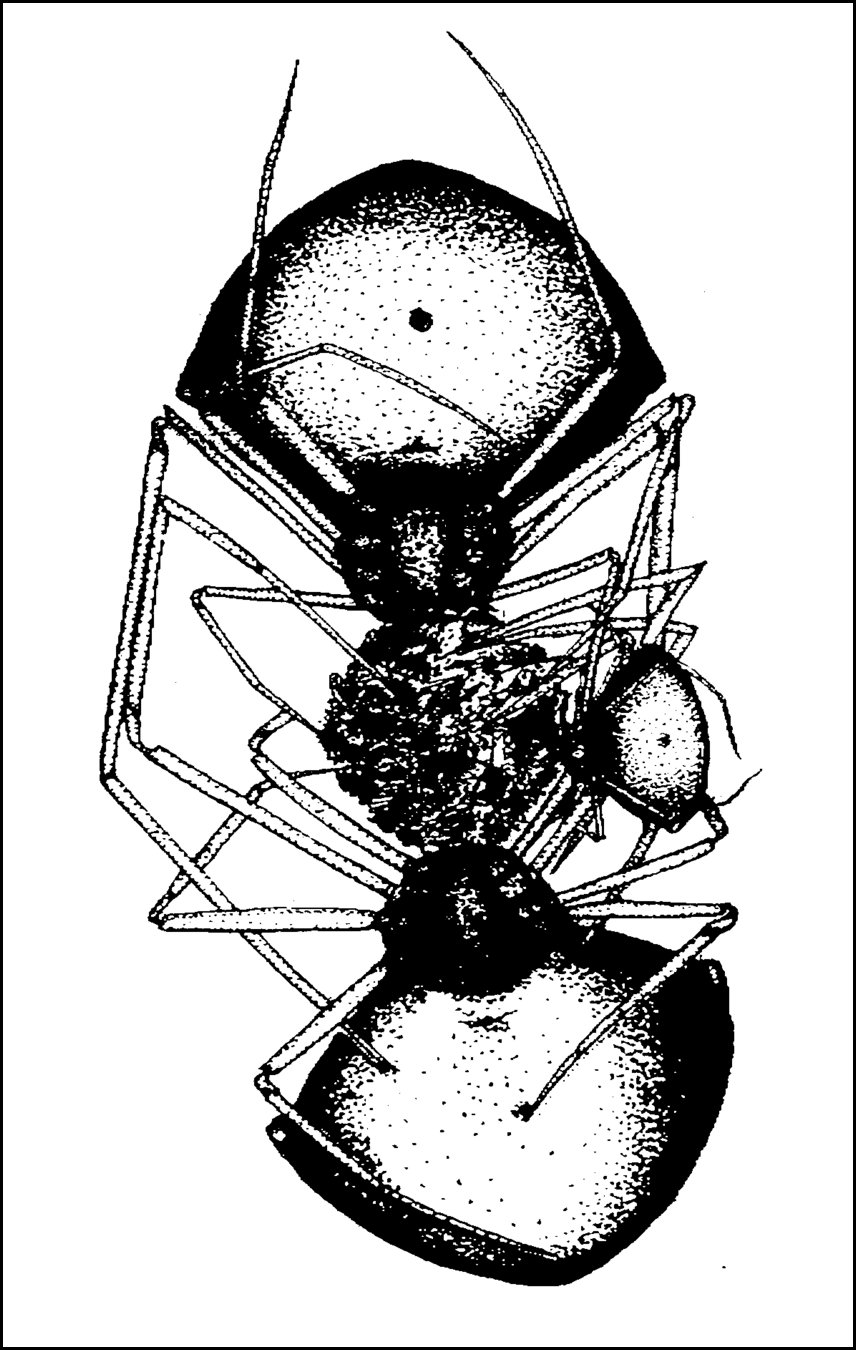 |
| Fig. 70 -"
Argyrodes"
flavipes, toile tridimensionnelle tendue entre deux feuilles (schéma) |
Fig.71- Fig. "Argyrodes"
flavipes. Deux femelles,
dont une avec son cocon, sous la feuille supérieure (photo) |
Fig. 72
-
"Argyrodes"
flavipes. Deux femelles
et un jeune se nourrissant en commun (schéma) |
| D'après Whitehouse & Jackson
(1998) |
Eberhard, W., 1979 - Argyrodes
attenuatus (Theridiidae): A web
that is not a snare. Psyche:
A
Journal of Entomology 86 (4), p. 407-414.
Gillespie R.G.
& M.A.Rivera,
2007.
- Free-living spiders of the
genus Ariamnes (Araneae,
Theridiidae) in Hawaii.
Journal of Arachnology,
April 2007, 35(1),
p.11-37.
Whitehouse,
M.E.A, 1987 - Spider eat spider: The predatory behavior of Rhomphaea
sp. from New Zealand. Journal
of Arachnology, 15, p. 355-362.